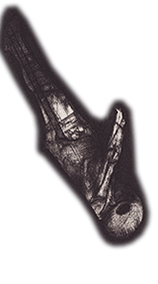Dado par Jean-Toussaint Desanti
L’obscène ou les malices du signifiant
Ce texte de Jean-Toussaint Desanti est initialement paru en octobre 1983 dans le numéro 29 de la revue Traverses éditée par le Centre Pompidou. Il avait alors été publié sans être accompagné de la reproduction du tableau de Dado dont parle Jean-Toussaint Desanti, à savoir L’Atelier (1972, huile sur toile, 195 × 365 cm). Le voici ici reproduit pour la première fois.
Télécharger le texte au format PDF.
Photos : Stéphane Rodier.
Cliquer sur les images pour les agrandir
en grand et très grand formats
❧
Diaporama
plein écran
Il est connu que le latin obscenus est un mot de la langue des augures : il désigne le mauvais signe, le présage fâcheux. Ce peut être un vol d’oiseaux, des entrailles de poulet, quelque événement insolite, qui se passe du mauvais côté. Encore faut-il s’entendre sur le mauvais côté : ce qui vient du côté gauche (sinister) peut être favorable ou défavorable selon que l’on regarde le sud ou le nord. De quel côté regarder ? Le rituel en décide. Les Étrusques regardaient le sud, les Grecs le nord. De toute manière, est de bon augure ce qui vient de l’est. Le côté de la nuit est fâcheux : obscenus dira-t-on.
Pris en ce sens aujourd’hui oublié, l’obscène n’est pas un objet de spectacle : pas pour tout le monde en tout cas : seuls les maîtres du rituel s’y attardent pour le scruter. Les autres, les gens du commun, se dépêchent de détourner les yeux. Ils pressent le pas, le regard baissé : qui sait quelle horreur habite ces lieux maudits ! Ne pas chercher à voir ; s’en remettre aux experts. Là est le refuge. L’œil doit demeurer pudique. Franchir la frontière est dangereux. Ce qui repousse la vue et pourtant se montre. Ce qui doit rester secret et pourtant s’exprime. Objet obscène ; parole obscène ; geste obscène. C’est en ce sens banal et quotidien qu’il est parlé aujourd’hui d’obscénité. Comme si le comble de l’obscène était, par exemple, de montrer son cul à la tribune d’un congrès de philosophie ! Inoffensive incongruité cependant ; sauf sur un point : elle fait violence à l’ordre des choses ou, pour parler autrement, elle dérange le déroulement attendu du spectacle.

Or, en son sens premier et fort, obscenus ne désignait rien de dérisoire. Au contraire, le mot désignait ce qui plus que tout doit inquiéter, puisqu’il y va de la suite et de l’ouverture du temps.
Obscenus a disparu de notre horizon. Mais « obscène » nous reste. Allons-nous l’abandonner à sa dérisoire banalité ? Nullement.

Je lis « obscène » et j’entends « ob‑scène ». Et quand j’entends « ob‑scène », je crois comprendre quelque chose du sens oublié d’« obscène ». Qu’il y ait un sens oublié cela veut dire sans doute que le sens usuel témoigne pour un autre qu’il dissimule cependant. Un sens assez inquiétant pour être dissimulé (ou exiger de l’être). Et c’est peut-être le poids propre de ce sens refoulé qui me porte à entendre « ob‑scène » sous « obscène », et à prendre au sérieux une homophonie de hasard. Pourquoi m’est-il si difficile de résister à une telle tentation, au point qu’il me semble tout naturel d’y céder ? Sans doute parce que je crois savoir d’expérience que l’obscène concerne de très près le sens de la vue, le devenir visible de ce qui se dissimule ; on pense au rideau qui se lève, et qui peut être un rideau de scène, mais aussi un voile qui recouvre la vérité d’un corps, parfois vivant, parfois mort. « Obscène » désignerait-il l’unité de la dissimulation et du dévoilement ? N’est-ce pas de ce côté qu’il convient de chercher à éprouver tout le poids d’inquiétude que l’usage du mot recèle ? Oui. C’est bien là le chemin qui s’ouvre. Et un exemple, visuel précisément, va nous aider à nous y engager.

Il existe un tableau de Dado que je vois souvent : chaque fois que je vais chez les amis qui le possèdent. Le hasard — encore un jeu du « signifiant » ? — me place toujours en face de lui. Il occupe à peu près l’espace d’un mur. Je ne l’ai pas sous les yeux à l’instant où j’écris. Mais la chose est sans importance puisque j’ai pris le parti de suivre la pente du rêve ; c’est-à-dire de me laisser conduire par ce que je soupçonne d’inquiétant dans le mot « obscène ».
La première fois que j’ai vu ce tableau, j’ai fermé les yeux. Il était accroché dans la salle à manger, à l’époque, et je ne pouvais, sans offenser mes amis, me lever de table. Le fait est que j’ai cherché à fuir : du même désir de fuite éprouvé une autre fois devant la peinture de Bacon, un matin. Je voulais voir, mais ne pouvais regarder. C’est pourquoi j’ai rouvert les yeux et me suis trouvé regardé par la peinture elle-même. Regardé : c’est-à-dire concerné, situé et repoussé. Dès lors, mon œil était capturé, comme si quelque chose d’épouvantable et de sacré, invisible dans le visible, s’était inscrit sur ce mur.
Je comprends maintenant pourquoi, lorsqu’il m’a été proposé d’écrire sur ce thème (l’Obscène) et que je ne savais trop comment m’y prendre, ce qui me rendait hésitant, je me décidai tout d’un coup en pensant à ce tableau. Je l’avais dans la tête comme indice du sens fort de l’obscène, de ce seul fait sans doute que la première fois où je l’avais vu, j’avais fui immobile ; sidéré, si l’on veut. Pourtant je ne crois pas aux mauvais présages, ni aux bons d’ailleurs. Mais quelque chose s’annonçait sur ce mur : un secret inquiétant et massif ; sur la toile, un au-delà de la toile laissait mes yeux orphelins : seuls et démunis.

Alors j’ai cherché où étaient les rats. Certainement il devait y avoir des rats. Trop de corps morts sur cette toile, affalés sur des chevalets ; des morts à grosse tête, à l’œil cyclope et aveugle. Les rats ne devaient pas être loin, tapis dans un coin, attendant de se hâter vers le festin. Or il n’y avait pas de rats. Rien qu’une grosse bête à oreilles pointues, vue de dos, en diagonale. Avait-elle à moitié dévoré quelques-uns de ces corps, aux entrailles ouvertes, aux membres déchirés ? Elle n’avait rien dévoré. Elle-même, solide sur ses pattes, portait les signes de sa mort. Morte depuis longtemps, depuis toujours peut-être, elle guettait des morts.
Étaient-ils morts seulement ? Ils avaient l’air très attentifs sur leurs chevalets avec leurs membres à demi déchirés, braquant des armes à forme familière, des sortes de canons. Peut-être avaient-ils longtemps attendu un ennemi qui n’était jamais venu. Et ils s’étaient usés à force d’attendre ; ils étaient tombés en désuétude, et maintenant il n’y avait plus personne pour les voir et les reconnaître dans le monde où ils se trouvaient, enflés et mutilés comme ils étaient. Étaient-ils vraiment mutilés ? Ces entrailles avaient-elles été vivantes ? Était-ce parce qu’elles ne l’avaient jamais été qu’il n’y avait pas de rats (et pourtant il m’avait bien semblé les voir : mais lorsque je m’étais approché ils avaient disparu) ? Était-ce pour cette raison que la bête n’avait jamais dévoré personne ? Peut-être avait-elle toujours été morte comme tous ceux qui étaient là, sur leurs chevalets, avec leurs armes inutiles. Tous ces gens, avec leurs membres coupés et leurs ventres ouverts, étaient d’une netteté minérale, dans une lumière glauque cependant, un air sulfureux, mais sans nuages. L’air, peut-être, avait dû les ronger. La chose devait s’être passée brusquement en des temps très anciens. Un mauvais vent les avait surpris dans leurs postures de défense. Et maintenant ils demeuraient morts de la façon même dont ils avaient été vivants : minéralisés. Peut-être…, peut-être…

Mais si je rassemble aujourd’hui quelques-unes des rêveries qui me passaient par la tête et si je me demande : « qu’est-ce que je cherchais en me racontant ces histoires…? », je suis bien contraint de répondre : « je cherchais l’invisible qui était présent sur ce mur, du fait de Dado ». Symboliquement, je cherchais « le rat » qui n’était pas visible et ne le serait jamais, mais il était là comme la puissance rongeuse de la mort. Tous les rats possibles, c’est-à-dire tous les éléments de destruction que peut comporter un monde, étaient présents en cette forme insistante, achevée et unique. Présents dans le regard cyclope de ces êtres minéraux, présents dans la désolation de ces charpentes disloquées, derrière les oreilles de cette bête, jadis féroce, maintenant immobile et rongée presque à demi. Présents aussi dans l’espace dessiné par ces chevalets dont on ne savait s’ils avaient été, au temps de la vie, des chevalets de peintre ou des chevalets de bourreau. Et de même que le sable se précipite et se dépose au fond de l’eau, de même dans la lumière de ce monde déserté, c’était la mort même qui s’était déposée. Un monde d’après la mort : voilà ce qui exigeait d’être vu sur ce mur, d’un bloc, dans la perfection de sa forme et l’équilibre de ses volumes. Ce qui me ramène invinciblement à cet autre désir de fuite devant la peinture de Bacon : lui aussi me donnait à voir, en un seul corps vivant, tous les corps morts possibles.

Ainsi l’effet de l’art peut, en certains cas, devenir profondément éthique : c’est-à-dire inquiéter sur le statut et la consistance du visible, ramené pour ainsi dire vers son inaccessible envers. Voir au cœur de leur endroit l’envers même des choses, cela n’est ni banal ni rassurant.
Ce n’est pourtant pas cet effet éthique qui suffit à produire l’effet d’obscénité. Je soupçonne que quelque chose manque encore à mon analyse. J’en vois un indice dans la différence fondamentale qui sépare, à mes yeux, Bacon de Dado, bien que chacun à sa manière mette l’œil à distance, en état de malaise, par l’effet d’un regard qui sort de la toile. Il me semble que jamais je n’irai chercher sur une toile de Bacon le rat symbolique, en dépit des chairs martyrisées et des corps tourbillonnants qu’elle expose. Il n’y a pas lieu : le « rat » n’y a pas de place. Pourquoi ? Sans doute parce que dans l’espace de la toile, il n’y a pas de lieu inoccupé. Cet espace se referme sur lui-même : chacun de ses manques, de ses vides, produit en tout autre un effet de fermeture. L’angoisse engendrée par la vue d’un espace clos, qui contient la mort et vous regarde, peut produire du tragique, mais non de l’obscène. Il en va tout autrement de la toile de Dado. Je ne parle pas ici de sa « facture ». Elle est tout à fait équilibrée, « bien composée », achevée si l’on veut. Mais ce qu’elle achève, c’est l’inachèvement même. Son espace, loin de se fermer sur lui-même, s’ouvre en chaque point sur on ne sait quel au-delà, d’où elle semble surgir dans une surabondance inquiétante (cf. les têtes démesurées des cyclopes minéraux). Un effet centrifuge, tout en médusant le regard, le chasse vers un autre lieu, qui n’est pas sur la toile.

« Obscène » donc : une surabondance d’être qui annonce le Rien et, ne se laissant pas refermer dans les limites du seul visible, occupe cependant tout lieu visible de son enflure envahissante. C’est pourquoi l’obscène, du même mouvement, force le regard et le repousse. Rien à voir avec le spectacle des sexes étalés. Une amie peintre ¹ à qui j’en parlais m’a dit que pour elle le comble du tableau obscène était Le miracle de la Sainte-Épine. Sans doute parce que les gens qui sont là sur cette toile, ne sont, comme ceux de Dado, ni tout à fait vivants ni tout à fait morts, ou peut-être toujours déjà morts.
Décidément la peinture n’est pas un art tranquille. Elle porte encore la trace de ce que, depuis l’origine, elle a comporté de sacré et d’interdit.
1. Françoise Gilot.