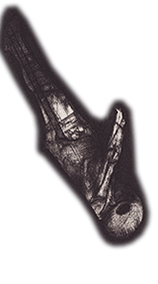Dado par Michael Peppiatt

Voici deux textes du critique et historien d’art Michael Peppiatt, commissaire de l’exposition Dado représentant le Monténégro à la 53e Biennale de Venise en 2009.
Le premier texte, Dado, noir sur blanc, est initialement paru dans la plaquette éditée à l’occasion de l’exposition de gravures de Dado à la Galerie Jeanne Bucher (Paris), du 14 mai au 14 juin 1975.
Le deuxième texte est un entretien extrait du catalogue publié à l’occasion de l’exposition de dessins de Dado à la Galerie Isy Brachot (Paris) du 16 novembre 1978 au 6 janvier 1979.![couverture Peindre debout]() On peut retrouver cet entretien, éclairé par un large appareil critique et de nombreuses notes contextuelles, dans le livre Peindre debout, publié en 2016 aux éditions L’Atelier contemporain – François-Marie Deyrolle éditeur avec le soutien à l’édition du Cnap.
On peut retrouver cet entretien, éclairé par un large appareil critique et de nombreuses notes contextuelles, dans le livre Peindre debout, publié en 2016 aux éditions L’Atelier contemporain – François-Marie Deyrolle éditeur avec le soutien à l’édition du Cnap.
L’ouvrage, préfacé par Anne Tronche, regroupe au total 23 entretiens réalisés avec Dado sur quatre décennies, édités et annotés par Amarante Szidon, fille de l’artiste.
En savoir plus sur le site de l’éditeur.
Cliquer sur les images pour les agrandir
en grand et très grand formats
❧
Diaporama
plein écran

Dado, noir sur blanc
À la première rencontre, et pendant un long moment après, on a du mal à retrouver en Dado la source d’une imagerie féroce. Sympathique compagnon qui adore traîner dans les rues des grandes villes, sociable à l’extrême, faisant boule de neige de ses amis, ouvert à tout propos, il ressemble bien peu au solitaire morbide et hanté que son art ne manque d’évoquer.
Déjà convaincante au long d’après-midi passées de trottoirs en cafés, l’impression qu’on s’est trompé d’artiste se précise chez lui à la campagne. Allant à Hérouval, où Dado habite depuis 1960, on est prêt à tout – à un chaos lugubre, à des entassements de grotesques minutieusement conservés – sauf à ce Vexin absurdement tendre. Pour avoir vu Dado dans cette beauté rieuse, entouré d’enfants et d’animaux nombreux, pour l’avoir suivi entre étang et roseraie vers un atelier en colombages, on doute encore plus que ce soit en lui – ici – que naissent ces fantasmes de terreur.

Peu à peu, pourtant, ses véritables obsessions se font clairement sentir. Il voit le chancre dans la rose. La santé, selon lui, serait l’attente de la maladie, comme la vie de la mort. Les yeux de ce Jekyll-et-Hyde monténégrin s’allument, sa voix s’emplit de chaleureux sous-entendus. Il se met à parler de désastres, de la sauvagerie et de la bêtise quotidiennes. Il s’attarde sur ce que les autres préfèrent en général passer sous silence. Il s’attendrit à la vue d’une acné galopante, il s’anime au souvenir de la masturbation collective à l’école en Yougoslavie. La vie l’obsède par ses aspects les plus vulnérables. À côté de lui, à table, on peut penser que ce n’est plus un bifteck mais un moment de mort qu’on découpe.
Dans la complicité qu’il fait naître, on se soucie peu de l’exactitude de ses récits ; on comprend que la réalité même lui paraît un désastre suffisant pour inclure toute exagération. Certainement, la cruauté de l’existence l’a marqué tôt. Il parle encore, par exemple, du râle du vieillard mort à côté de lui à l’hôpital ; des maquisards pendus en place publique et exposés pendant plusieurs jours par les Allemands.

L’horreur et la peur sont enracinées dans sa vie depuis toujours. Dans son art, il les fait ressortir, il les réinvente. Il en tire des tours de force baroques, les pousse à de nouveaux extrêmes, raffinant chaque détail pour qu’il perce de la manière la plus insidieuse. De cette activité obsessionnelle est sortie une terrible famille pullulante d’estropiés, de débiles, de monstres somptueusement décrits. Ce sont les acteurs d’une grande comédie inhumaine, pris au dernier stade de dégénérescence, où ce qui reste de vie appartient déjà à la mort.
La chair glisse de l’os et de nouvelles blessures s’ouvrent. Curieusement, l’atmosphère est moins désespérée que la condition des victimes ne le suggère. En dépit de la variété maniaque des tortures qu’ils subissent, des éclairs d’humour – parfois de gaieté obscène – les traversent. Derrière eux, dans la sérénité du ciel, on croit entendre l’écho d’un énorme rire moqueur.

Dado se soucie, avant tout autre chose, de la justesse plastique de chacune de ses œuvres. La chair devient non seulement le moyen le plus sensible pour communiquer son sentiment intime de la vie, mais aussi une espèce de pâte à invention picturale sans fin. Dans cette matière qui nous est si proche, toute invention véritable ne saurait que blesser.
∗
∗ ∗
Quand ce « gentil bourreau » (c’est ainsi que s’appelle Dado) poursuit ses victimes au burin, les mêmes obsessions – on s’y attendait – prennent forme, mais elles sont transmises avec une autre intensité. L’horreur, la cruauté grotesque paraissent plus concentrées, plus littérales. Le ciel innocent du Vexin s’est définitivement éclipsé ; sur les corps, une lueur grise a avalé le rose frais. Tout ici se situe entre le noir total et le néant encore plus profond du blanc. Issues des deux extrêmes de la couleur, ces scènes de dégradation ont une autorité accrue. Pour être sortis de cette nuit d’encre, pour s’être matérialisés dans ce vide incolore, les personnages se présentent avec une puissance de fait.


Dado grave comme il peint : il commence par une image qu’il ne cesse, par la suite, de retravailler et transformer. Des mois, des années même, s’écoulent entre un état premier ou intermédiaire et l’état final d’une de ses gravures. La composition est souvent entièrement réorganisée, à tel point que la plaque change du vertical à l’horizontal et qu’il reste à peine un détail de la composition initiale. Plusieurs de ces plaques-palimpsestes conservent, enfouie dans le métal, l’histoire de leurs mutations. Dans le fond noir, sous la couche de résine qui les enferme, les pâles silhouettes d’images rejetées rôdent encore, comme dans un miroir détruit.
Exprimée ainsi, noir sur blanc, cette vision frappe par une acuité sobre et directe. Là où la peinture de Dado se fait surface d’une chair infectée, son burin la recherche en profondeur, creusant et égratignant le corps comme l’agent même de la maladie. Il écarte et enlève avec l’insistance d’un couteau de chirurgien. A la suite de tant d’interventions subtiles, les corps deviennent plus fragiles que jamais ; leur chair est si ténue qu’elle semble avoir été tissée, comme une toile d’araignée, autour des os.


>À droite : Le Manipulateur II, 1973, pointe sèche et aquatinte, 38 × 50 cm. Alain Controu, imprimeur.


À droite : Ivrogne battant un enfant II, 1974, pointe sèche et aquatinte, 50 × 40 cm. Alain Controu, imprimeur.


À droite : Montenegro II, 1974, pointe sèche et aquatinte, 48 × 38 cm. Alain Controu, imprimeur.
Dans cette anthologie de la pourriture, seuls quelques rongeurs alertes et une poignée d’objets semblent faits pour survivre. La chaise en fer se maintient nette et élégante sous le corps qui s’y décompose, sans doute depuis des années ; la chambre où les enfants se cassent comme des statuettes de porcelaine reste remarquablement intacte. Seul le grillage auquel Dado revient si fréquemment imite la chair, mourant à petites sections, semblables à des cellules.
Malgré les contraintes du technique, Dado a su garder la fluidité qu’il a dans sa peinture. Ou plutôt il est parvenu à la recréer, après avoir manipulé toutes les ressources du métier. Cette plasticité inhabituelle dépend dans une grande mesure de la gamme et de la subtilité des teintes : du noir riche et velouté au gris clair corrosif. La réussite technique, qu’on ne pourrait manifestement séparer de la réussite artistique, est le résultat d’années d’étroite collaboration entre l’artiste et son imprimeur, Alain Controu. Depuis 1967, date à laquelle Controu a intéressé Dado à la gravure, ils ont travaillé ensemble régulièrement à élargir les possibilités techniques, à mettre au point des moyens plus souples et mieux adaptés aux transformations constantes. Aucune partie du travail de l’un ne pouvait être menée à bien sans l’autre. C’est pourquoi cette exposition témoigne non seulement de l’invention et de la prouesse du graveur, mais également du savoir et de la passion de l’imprimeur.
Michael Peppiatt


À droite : Rhinoceros II, 1973, pointe sèche, 50 × 40 cm. Alain Controu, imprimeur.


À droite : La Chaude Pisse, 1973, pointe sèche, 23,5 × 17,5 cm. Alain Controu, imprimeur.


À droite : Le chemin de croix II, 1974, pointe sèche et aquatinte, 48 × 38 cm. Alain Controu, imprimeur.


À droite : Rhinoceros V, 1974, pointe sèche et aquatinte, 47,5 × 37,5 cm. Alain Controu, imprimeur.
D’un entretien avec Dado

© Centre Pompidou, Mnam-Cci, Bibliothèque Kandinsky, Paris. Photo : Jacques Faujour.
Cet entretien recoupe et résume trois interviews distinctes. Le tout a été enregistré au magnétophone, mais telle une traduction littérale, la transcription qui suit enlève de multiples nuances. L’emphase ironique, les hésitations, l’amour-propre piqué, la malice chaleureuse, tout le jeu complice du chasseur-de-propos et de sa proie (qui veut bien être prise, mais sur son propre terrain…) disparaît une fois rassemblé noir sur blanc. Disparaissent également les rires, qui n’étaient jamais longtemps absents, les gestes, les clins d’œil. Au lecteur de les remettre à son gré, peut-être réanimant ainsi ces propos pris sur le vif.
Dado : Depuis deux ans et demi, je dessine pratiquement tous les jours, surtout quand il n’y a plus de lumière, vers le soir ou pendant l’hiver. Après la fatigue des grands tableaux à l’huile, les dessins à la plume étaient censés être un genre de repos – ou du moins un moyen d’échapper à la peinture et de la retrouver avec d’autres yeux. Seulement il est aussi difficile de sortir un bon dessin qu’un bon tableau, et cela n’avait rien de reposant, parce que pour faire quoi que ce soit il faut être tendu… Il y a une grande complicité, je crois, entre mes tableaux et mes dessins. Ils se font à un rythme différent, mais aussi dur et lent l’un que l’autre. Parfois je sentais que la peinture commençait à se manifester trop dans le dessin – quand le dessin devenait trop liquide, trop modelé – et j’ai dû arrêter tout de suite et recommencer.
Est-ce que tu poursuis les mêmes préoccupations en dessinant qu’en faisant des tableaux ?
Je ne poursuis pas des préoccupations. Ce sont elles qui me poursuivent !

Mais dans les deux cas…
Ce qui m’intéresse dans le dessin, tu vois, c’est le côté austère, terriblement austère. Ça n’a aucun attrait. C’est dur, comme du sel. Dessiner à la plume, c’est disons soixante fois plus lent d’exécution que de dessiner à la mine de plomb. La plume te freine, et il faut presque entailler le papier, comme un tatouage – parce que le papier a une grande vulnérabilité, un côté « derme ». Je voulais, chaque fois que j’étais plongé dedans, que la feuille subisse comme une pluie de venin, mais qu’elle devienne finalement belle.
Est-ce qu’il t’arrive d’effacer, ou de faire plusieurs couches, comme dans les tableaux ?
Non. C’est justement ça qui est terrible dans le dessin à la plume. Tout reste, tout est enregistré comme une espèce d’électrocardiogramme. Et pour moi ce qu’il y a de plus beau, bien sûr, c’est quand les volumes et les blancs se forment d’une façon que je n’aurais jamais imaginée.
Quand tu commences à dessiner, est-ce que tu as déjà une image en tête ?
Non. Absolument pas. Je suis incapable d’imaginer un dessin, de le sentir dès le départ. Je n’ai jamais su ce que c’est que d’avoir une idée dans ce sens-là. Je cherche surtout à me plonger ailleurs quand je travaille, à échapper à la vie. Et les choses que j’ai peut-être réussies, les rares fois où ça arrive, ça arrive comme un malheur, comme une tuile en quelque sorte – plaff ! comme ça.


À droite : Adam’s Hotel, 1978, encre de Chine, encre de couleur et crayon sur papier, 65 × 49 cm.
L’art pour toi est un moyen d’échapper ?
Il me semble que tout art, pas simplement le mien, est fatalement la recherche d’une autre vie. C’est un moyen d’échapper si on veut, mais ce qui est terrible, et ce qui est surtout intéressant dans l’art, c’est qu’il mène à une auto-trahison. On peut essayer de s’évader et d’éviter de dire les choses qui vous tourmentent, mais elles apparaissent toujours.
L’art finit toujours par dire la vérité…
Exactement. Comme dans une espèce de délire. Ou de confession. Et puisque je me vois mal fréquenter les curés, les analystes, les petits connards et tout ça… À mon sens, le travail que je fais est parallèle à la réalité. Je crois qu’il est une réalité de plus – c’est terriblement prétentieux de le dire, peut-être. Ce n’est pas la réalité dans laquelle nous vivons, ce n’est même pas ma propre réalité, puisque la réalité de mon travail devient plus grande que la mienne, qui est misérable, comme celle de chacun. Cela dit, je crois que le drame que je vis avec mon travail n’est pas plus digne d’intérêt que le drame de quelqu’un qui a du mal à marcher.


Pourquoi est-ce que cette réalité comporte une telle obsession avec les corps en pourriture ?
Les corps en pourriture ? On m’a souvent parlé de pourriture par rapport à mon travail, mais je ne crois pas que ce soit forcément ça. C’est le côté superficiel, purement folklorique, ça. Tu sais, ce qui me fascine, c’est cette complexité extraordinaire, incalculable, qu’est un corps humain. Parce que quand on voit un visage ou un corps, on ne voit pas que le côté derme – on voit tout, en fait, même sans le voir ou le toucher. Je peux très bien imaginer quelqu’un qui est amoureux vouloir toucher les nerfs, les reins, les organes de l’autre. Pour moi, si tu veux, le corps humain c’est tout l’univers, un monde total et unique.
Mais cette race de personnages étranges : d’où est-ce qu’elle sort ?
Bien, je n’en sais rien.
Tu n’en sais rien, ou tu ne veux pas le dire ?
Je n’ose pas…
Est-ce que tu es superstitieux, dans le sens que si tu le disais ça pourrait disparaître ?
Disons que ce n’est pas ma peinture ou mon dessin qui me font peur, mais le vide d’où ils viennent. Je ne sais pas ce que c’est que ce vide. Et je ne le sais pas délibérément parce que je ne veux pas le savoir. De toute façon ce vide est tout autour de nous, chaque personne, chaque objet baigne dedans.

Tu n’aimes pas essayer d’analyser ces choses-là ?
J’ai horreur de l’analyse. Ça nous mène toujours dans les bricolages qui sont au goût du jour. Toute analyse me paraît absurde, inconcevable. Moi-même je ne peux que constater certaines choses quand je bute dessus.
Il y a tant de membres déchiquetés, tant de chairs en déliquescence que ton intérêt ne peut pas être simplement anatomique. C’est plutôt une obsession de la mort ?
Oui. Pour moi, la grave horreur c’est que tout est basé sur le fait qu’il y a la vie, la mort, les bons, les méchants. Toutes les conneries possibles viennent de là. Je crois qu’il y a dès le départ une débilité universelle et permanente, même s’il y a des gens prodigieusement intelligents de temps en temps…
Mais est-ce que tu es particulièrement conscient du fait de la mort ? Les gens qui regardent tes œuvres sont souvent mal à l’aise. Au premier contact, il y a un choc chez beaucoup, même un mouvement de répulsion.
Tu trouves ? Quel compliment ! Je suis gâté ce matin.
Tu t’en es rendu compte quand même.
Non. Pas vraiment. Je ne peux pas savoir ce que les gens ressentent devant mon travail. Mais, tu sais, avec le temps je me demande si les mutilations physiques sont pires que les choses sournoises, les choses méchantes, les humiliations… Le côté physique est peut-être simplement plus spectaculaire comme atteinte. Je mets tout dans mon dessin, je ne me contrôle absolument pas, et ça me fait découvrir un tas de choses.
Pourtant tu restes sensible avant tout à la vulnérabilité et à la destruction.
Je ne suis que ça, vulnérabilité et destruction. Ce serait ridicule de le cacher. Les artistes ressemblent toujours à leur œuvre.

Est-ce que les personnages que tu crées ont parfois un rapport avec d’autres images – photographiques, par exemple – ou avec des gens que tu aurais pu entrevoir quelque part, comme tous ces hommes au crâne chauve que nous avons remarqués à la Coupole ?
Non. Par contre, tragiquement ou comiquement, il arrive que lorsque j’ai fait un dessin, le personnage que je viens de faire passe devant la fenêtre.
Ce serait plutôt la vie qui imite l’art ?
Exactement. Si le dessin marche bien, tout pose pour moi.
∗
∗ ∗
Tout au début, tu as commencé par faire des portraits, je crois.
Oui, quand j’étais gosse dans ma maison au Monténégro, j’ai dessiné mon père et ensuite mes camarades, et je leur disais de faire des grimaces. C’est comme ça que je suis entré dans ce monde de visages tordus. J’ai été tout de suite à la recherche de choses saugrenues. Puis, très tôt, vers dix-sept ou dix-huit ans, j’ai commencé à faire des personnages qui n’avaient plus rien à voir avec l’apparence conventionnelle – ce qui m’a posé pas mal de problèmes à l’école d’art que je fréquentais.
C’était déjà un monde de fantaisie ?
Oui. Si tu veux, c’était une espèce de mauvais rêve qui commençait. Et qui dure trente ans plus tard.
Quel rapport avait-il avec ta vie ?
Disons que mon travail est un mauvais rêve et ma vie est un deuxième mauvais rêve. Et que parfois dans toute cette confusion il y a des choses qui se dégagent, des moments lumineux. Mais je n’ai jamais pu, à vrai dire, séparer le rêve de la réalité. C’est un peu la raison pour laquelle je suis entêté dans la peinture. Pourquoi le rêve n’est-il pas la réalité, et pourquoi quand les flics t’arrêtent c’est une réalité ?

Comment est-ce que ton dessin s’est développé, selon toi ?
C’est l’écriture qui a été libérée, qui est devenue plus aventureuse – si tu veux que je joue au critique d’art. Mais c’est la même difficulté d’être qui se manifeste. C’est un bien grand mot peut-être, mais je crois que je ne peux pas le cacher, c’est évident qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Que tu acceptes ?
Si je refuse ça, je refuse tout en bloc. On ne peut pas changer sa vie, à vrai dire, contrairement à toutes les théories à la mode aujourd’hui.


À droite : Sans titre, 1969, encre sur papier, 64 × 50 cm.
Est-ce qu’il y a un thème qui relie les dessins ? J’ai l’impression que certains en ont suggéré d’autres.
C’est vrai. Tout s’enchaîne. Il n’y a qu’un seul dessin qui n’est jamais terminé et qui va jusqu’à l’horizon. C’est ça qui m’excite, tu vois. Mais il n’y a pas vraiment de thème.
Ce sont l’espace et les rapports plastiques qui t’intéressent, peut-être exclusivement ?
Bien sûr. La question ne se pose même pas. C’est-à-dire que quand je suis conscient du côté purement plastique, je suis sur la bonne voie et je ne suis pas en train de refaire quelque chose que j’aurais vu dans « Paris Match » ou un des crânes chauves de la Coupole, tu vois ?
À quel moment est-ce que tu sais que tu dois arrêter de travailler sur un dessin ?
Quand j’ai besoin de toucher du fric ! Non, tu sais, je n’ai jamais l’impression d’avoir fini quoi que ce soit. Mais il y a toujours quelque chose qui arrive et qui fait que je les tourne au mur et que je commence à nouveau… En fin de compte, je crois que ma fantaisie, comme tu l’as appelée, est une sorte de réalité. Je crois que mes dessins contiennent ce que Victor Brauner appelait des « signes avant-coureurs » – des indications de choses qui vont nous arriver.

Dans le vieillissement ?
Comme il n’arrive que des vilaines choses dans la vie la plupart du temps – ben, on ne va pas faire un manuel du désespoir, mais on dit que le temps va arranger les choses, et c’est complètement faux. C’est un gentil mot pour les enfants, mais à huit ans on a déjà compris que le temps n’arrange rien, bien au contraire, il bouffe, il détruit !
Et ce sentiment se traduit forcément dans ton travail.
Bien sûr. Mon travail est une espèce de journal intime – un carnet de voyage sur place, si tu veux. C’est un document qui est censé ne pas être ennuyeux : ce qu’on peut appeler « art », je crois. C’est-à-dire : devoir parler de choses sans savoir pourquoi… Et pour obtenir quelque chose de bon, il faut que ce soit difficile. Je peux faire toutes sortes d’images très facilement, mais elles ne valent rien. Il faut qu’il y ait eu la difficulté et la peine, il faut se les imposer. Sinon c’est du prêt-à-porter, tu vois. Il faut que ton dessin ou ton tableau arrive comme une maladie éruptive, sans qu’on sache pourquoi. Voilà. C’est pour ça que je ne peux pas l’analyser et qu’on ne peut pas appliquer à mon travail des barèmes esthétiques ou philosophiques ou quoi que ce soit. On ne peut que le subir – si on en a envie !