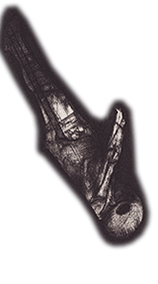Dado par Bernard Noël
Voici deux textes de Bernard Noël. Le deuxième texte, Le Multiplicateur, est extrait du catalogue publié à l’occasion de l’exposition de dessins de Dado à la Galerie Isy Brachot (Paris) du 16 novembre 1978 au 6 janvier 1979.
Cliquer sur les images pour les agrandir
en grand et très grand formats
❧
Diaporama
plein écran

Ce mot a surgi en même temps que le souvenir d’avoir été conduit par François à la première exposition Dado chez Jeanne-Bucher, en 1971. Aucune autre exposition n’a eu, sur moi, pareil effet : la vision, bien que violemment occupée, a soudain reflué sous la poussée d’une invasion interne analogue à un vertige.
L’espace de la galerie était contaminé par l’énergie émanant des toiles et il était bleu. D’un bleu mêlé d’une poussière blanche si pénétrante qu’elle poudroyait à l’intérieur du corps et y transportait le théâtre de la scène peinte.
D’ordinaire, on se campe devant une toile et le face à face va son chemin selon l’attrait exercé par la chose peinte. Les places respectives sont fixées une fois pour toutes que le spectateur fasse ou non la peinture. Cette fois-là, il en allait autrement parce que la peinture débordait. François m’avait prévenu : « Il va falloir te cramponner ! » Et il avait exigé une visite matinale pour la raison qu’à ce moment de la journée la galerie serait probablement vide.

73,5 × 48 × 40,5 cm.
L’image de Dado éblouit autant par son originalité que par sa fureur ; elle va jusqu’à crever les yeux par la projection de l’insoutenable, et cependant, dès qu’on l’affronte, tout cela se retire dans une condensation explosive : une sorte de rassemblement orageux dont l’énergie balaie le regard quand celui-ci en touche la surface. Si on se laisse fasciner par l’image, on manque l’essentiel, qui est ce tourbillon d’énergie déposé dans les figures et dans leur agencement. La violence figurée est le déclencheur de cet élan, elle assure également la synthèse entre l’acte qui représente et la précipitation qui transforme la réception de l’image en expérience physique.
En fait, Dado exacerbe le paradoxe de la peinture figurative, qui est de jeter l’image vers sa perte par l’exaltation de son expressivité. Ainsi nous place-t-il devant des figures aux postures si excessives qu’elles frôlent la caricature à l’instant même où elles nous montrent la torsion qui arrache la vie.
L’horreur est là, évidente, mais sa manière de distendre les formes tire d’elles un rire dément dont le pinceau répand partout les éclats. À force de boucles, de barres, de coulures, de glissades, de transparences, le spectacle change partout de ton comme si le drame versait sans cesse dans la farce tragique puis se volatilisait dans une flambée de couleurs dont la vivacité met de l’élévation dans le désastre.

70,5 × 49 × 20,5 cm.
Cela est vrai et faux : vrai si l’on s’en tient à la surface de l’image ; faux si on la traverse pour envisager ce qui la constitue. Toutefois, l’accumulation du monstrueux doit répondre à une nécessité.
Les grands peintres se renouvellent à l’intérieur d’une continuité. Il est clair que Dado ne s’obstine ni à choquer ni à surprendre, car ce mouvement deviendrait à la longue systématique et par conséquent superficiel. Autre chose est forcément en jeu. Cette chose, du moins au premier degré, est sans doute en rapport avec les atrocités de notre époque, mais cet horizon serait pauvrement symbolique s’il se limitait là.
Beaucoup de titres – et depuis le début – suggèrent une galerie de portraits. Sous des noms de personnages fictifs ou réels, ce sont des forces qui sont portraiturées sans aucun souci de ressemblance ni même de vraisemblance. D’ailleurs, une germination envahit l’image, et elle ronge la représentation de l’intérieur au lieu d’y favoriser références et simulacres.

82,5 × 53,5 × 46,5 cm.
L’image ne dépeint pas du massacré, du charnel, du pantelant, elle en contient et, de ce fait, le donne à voir par impression plutôt que par vision. Cette différence est capitale pour la raison que, devant cette œuvre, la vue n’est agrippée d’abord que dans la mesure où elle est l’un de nos sens et, en tant que telle, capable de déclencher une participation physique. Il ne suffit pas de parler d’émotion car c’est le corps tout entier qui est visé afin qu’il soit mis en état de recevoir la force développée par la peinture et de la métamorphoser en impulsion organique. Pour cela, après avoir été intériorisée, il faut que la vue du tableau se change en événement interne quitte à provoquer une poussée de violence. Nous sommes loin des petites excitations décoratives et rétiniennes si prisées de nos jours par les institutions.
Le recours à l’image entraîne le recours à la simulation, mais il a pour palliatif ce mystère : la fausse viande peut, par ingestion mentale, avoir un effet vrai. L’univers symbolique ne donne pas seulement lieu à des opérations intellectuelles, il lui arrive d’agir à la manière des forces naturelles, qui ont le pouvoir de nous impressionner bien avant d’être nommées ou personnifiées. Contraint d’en passer par les symboles, l’artiste a le choix entre un langage où prime l’articulation (la réflexion) et un langage où prime l’effusion (l’émotion). Libre à lui de considérer, ou non, que ce dernier est le plus littéral parce que le plus immédiat.

85,5 × 57 × 11 cm.
Les boîtes et les sculptures des années 1990 ont préparé cette orientation avec leurs assemblages d’objets hétéroclites – bouts de bois, bidons, crânes, momies de chats et de renards, ossements, chaussures, chaudrons, radiateurs, etc. – métamorphosés en visions d’équarrissage ou de dissection. Mais bien avant, il y avait eu déjà les collections d’os décorés à la plume et la fameuse voiture bardée d’ossements « la Traction avant ».

111,5 × 71 × 22,5 cm.
Constamment, le geste de Dado aura analysé l’image, on pourrait dire qu’il s’en extrait aujourd’hui pour se manifester tel qu’en lui-même. Autrement dit, après s’être vêtu de figures, le geste se fait chair et réalise son incarnation à travers des matériaux déchus auxquels son empreinte donne forme.
L’hybridation ne produit pas seulement des monstres, elle se dissimule dans l’acte qui nous tient le plus à cœur et qui, par un certain travail, consiste à croiser le temps de notre vie avec les gestes en train de créer une « œuvre ». Il y aurait ainsi de la monstruosité dans toute création parce que celle-ci dénature l’énergie destinée à servir l’espèce en la mettant au service d’une entreprise particulière. Cette situation demeure imperceptible tant qu’elle semble ne relever que d’opérations intellectuelles, mais qu’un artiste mette en scène le théâtre anatomique qui en est le sous-bassement et quelque chose éclate dans la violence. La peinture de Dado touche à ce dérèglement charnel qui est derrière les œuvres : elle y touche par ses thèmes, par ses matériaux, par ses couleurs, et elle doit à ce vertigineux travail sur le vif le pouvoir qu’elle a de nous troubler physiquement.
∗
∗ ∗
Le Multiplicateur

Voici donc des dessins où quelque chose d’assez monstrueux se répand, prolifère. On déchiffre : visages, grimaces, becs, os, dents, sexes, orbites, bouches, nez-bec, mais l’accumulation précipite le regard lisant, et elle produit un tremblé dans lequel tous ces détails perdent leurs noms, leurs référents : il y a brouillage des éléments qui sont les repères du sens au profit d’une impression. Ainsi, ce qui dérange dans les dessins de Dado, c’est moins ce qu’ils montrent qu’une manière de suractiver la représentation en conjuguant des moyens contradictoires : fragmentation et unité dynamique.
Premier effet : on oublie de reconnaître ce qui est nettement représenté, et la scène change : plus d’anecdotes, rien que de l’action. Un malheur. Et toujours sur le vif. En accumulant des détails, Dado crée une vitesse, qui annule le détaillé, car elle rend significatif son ensemble. Le grouillant ne grouille que pour accélérer une formation à travers laquelle il s’ordonne et choque massivement. Ce choc arrête la description, la lecture : ce dont il est fait importe moins que de savoir ce qu’il est ?

Mais ce qu’il est, tout en n’étant pas réductible aux éléments qui le composent, n’en est pas distinct : c’est le coup de force de Dado, dans l’art dit figuratif, que de dédoubler sans cesse le figuré en le multipliant. Ce mouvement de multiplication, au lieu d’insister sur la figuration, la vide au profit de lui-même, seulement l’effet qu’il produit ressemble à celui que pourrait produire chacun de ses composants. Il s’en suit que, si tous les fragments sont chargés, leur charge globale est infiniment supérieure à leur somme : elle en est l’excès.


À droite : Sans titre, 1978, encre et aquarelle sur papier, 77 × 57 cm. Courtesy Archives Brachot.
Cet excès, toutefois, opère en étant lisible – si l’on veut ! – dans toutes les parties du dessin, mais chaque partie n’est qu’un point d’appui, où l’élan général se relance. On voit donc que la série des effets : vitesse, choc, excès, ne se met en place qu’en rivalité avec une autre série : détails, éléments, fragments, dont la contradiction lui est nécessaire. Et la conséquence de cet état de tension est que la moindre partie fait corps avec l’ensemble – d’où, pour le spectateur, un perpétuel désir de tout ce corps.
L’espace du regard en est complètement changé : de la surface du dessin à l’œil, il ne fait plus circuler de l’information, du savoir, mais ce désir qui veut voir davantage. Le regard peut, aussi, lire chaque fragment, savoir que ce visage est un cri, cet autre une écorchure, cet autre encore une défiguration, mais cela est trop peu : il généralise, et vient un emportement, qui ne lui apprend rien, qui le pousse à l’excès.

Pourquoi ? Peut-être parce que leur immobilité est cet état impossible où nous voudrions être, dans un toujours qui serait un défi au vent de la mort, qui est aussi leur vent. L’immédiat n’est pas un lieu, il est un suspens sur une lisière mouvante, où nous sommes présents – rien que présents. Dans l’éclair de cette présence, notre regard et notre relation sont libres de toute censure : ils sont physiques, uniquement. Dado nous projette là, visionnairement, et sa danse macabre est alors la fête du vif.
Bernard Noël