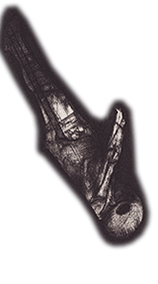Dado par Alain Jouffroy
Dado ou la générosité du matin
Ce texte d’Alain Jouffroy est initialement paru en juin 1974 dans le no 42 de la revue XXe siècle (p. 55-63).

Cliquer sur les images pour les agrandir
en grand et très grand formats
❧
Diaporama
plein écran



Les Monténégrins, proches des Albanais, forment une communauté minoritaire qui a produit, pendant la guerre, les plus courageux résistants contre l’ordre nazi. On les jalouse d’autant plus que leur héroïsme est si manifeste qu’il en devient gênant pour tout le monde. Plus indépendants par le tempérament que par l’idéologie, ils ne font pas facilement ce qu’on appelle des « concessions ». Dado, qui a gardé la citoyenneté yougoslave, et qui n’a donc jamais songé à bénéficier en France du statut, assez ambigu, de « réfugié politique », s’est donc affirmé jusqu’à aujourd’hui comme le membre d’une communauté obscure, dont les traditions échappent à la connaissance de la plupart des gens. Sa peinture affirme cette hétérogénéité fondamentale par rapport à notre culture : elle n’est perceptible qu’à distance et nous condamne, nous, au statut d’étrangers. Nous sommes exclus de cet univers ; c’est à nous de faire l’effort d’y pénétrer, d’y frayer un chemin. Je ne suis pas encore parvenu à en faire la connaissance intime, malgré la fascination qu’exercent sur moi ses tableaux depuis 1958, date de sa première exposition à Paris. En quinze ans, je crois n’avoir procédé qu’à quelques brèves incursions au pays mental de Dado, et c’est toujours avec une certaine consternation que je sors de ses expositions, comme si je me sentais mis à distance par un homme qui se moque de tous mes critères, et qui parvient à m’émouvoir, à m’inquiéter, à me poser des questions sans jamais utiliser le langage qui devrait en principe me convenir pour établir avec moi une espèce de dialogue sans mots qu’on appelle la compréhension.
On a beau dire que nous avons assis la beauté sur nos genoux, et que nous lui avons craché à la figure, la beauté continue de nous échapper. Nous ne savons pas ce que c’est. Parfois, c’est la laideur même dont elle prend le masque, et nous découvrons soudain la beauté qui nous entoure, comme si nous étions aveuglés par tout ce qui la contredit. De même, quand il s’agit de tableaux, nous préférons la plupart du temps omettre la question de leur « beauté », comme si nous avions honte d’avouer que nous la confondons le plus souvent avec l’élégance, le goût, qui n’en sont que les dérivations plus ou moins nécessaires. Or, les tableaux de Dado nous tiennent sous un charme si spécial qu’ils inondent la laideur du monde de toute la beauté du monde. Les deux puissances qui nous dirigent, l’instinct de vie et la volonté de mort, s’y livrent un combat fabuleux, dont nous ne saurons jamais affirmer qui en sort finalement vainqueur. La destruction, la guerre, la catastrophe s’y accouplent à l’amour, à la fête, au plaisir de s’enivrer de vie. C’est la nuit du tombeau, les vers grouillant dans les cadavres, les blessés agonisants du champ de bataille, les amputés, les monstres, les idiots, et c’est aussi le jour de la naissance, l’aube à la lisière de la forêt, le matin de la connaissance, l’entrée au paradis fabuleux des animaux et des légendes.

Dans ses plus récents tableaux, ce ne sont plus des femmes jaillies d’une porte et criant « au feu » ou des hommes qu’on jette à la rue avec leurs draps, leurs souliers, leur bric-à-brac, ni des monstres étalés sur les plages, dans les piscines, ou dans les terrains vagues qui séparent en banlieue les H.L.M. de la hâte et de l’avarice sociales, mais des oiseaux emblématiques, des animaux de fable, autour du Christ de saint Hubert. La thématique « religieuse » de Dado, qui émergeait à la dernière exposition chez Jeanne-Bucher, et qui sera encore plus visible à l’exposition du musée Boymans de Rotterdam, n’obéit donc à aucune espèce d’orthodoxie : les « Christ » de Dado sont des chefs de bande, des barbares, des princes usurpateurs cloués au pilori, et qui demandent au peuple de danser autour de leur poteau de supplice.

Aucune idée de supériorité divine, ni même d’« intercesseur » transcendantal entre deux mondes, mais le spectacle toujours ahurissant, fascinant, terrifiant, aberrant, de la folie humaine : le carnage, la provocation, la bestialité, la pompe, la magie, la fuite, la frénésie, l’orgie, la prophétie, la transgression, la démesure, la conjuration de toutes les puissances hostiles à l’individu. Une sorte de fin du monde où, à chaque instant, il s’agirait de réinventer à toute vitesse les choses, les êtres, les plantes, les pierres, le ciel, les animaux, la matière même. Hors-temps peut-être, ou plutôt dans l’éternité qui lie la préhistoire au monde moderne, les besoins les plus primitifs, la faim, la soif, l’instinct de conservation, aux données les plus complexes de l’intelligence : le rituel de la pensée, le décryptage incessant des signes, la transformation des formes, la métamorphose inarrêtable de la pensée.

Depuis quelques années, c’est la lumière que Dado a captée, et comme on ne l’avait jamais vue peut-être, effleurer les choses : une lumière de quatre heures du matin, l’été, veloutée serait peu dire, mais cendreuse comme l’aile de certains papillons, ceux qui ne vivent qu’un jour, que quelques heures, entre les fleurs qui viennent d’éclore et les brumes qui viennent de se lever. C’est donc la philosophie la plus distante qui éclaire ces magmas, ces débris, ce fatras gigantesque – celle de la retenue, de l’isolement, de la pudeur extrême. Le monde est inacceptable, on le sait, mais la pensée qui l’éclaire le change en signes, en intersignes, en prémonition de la merveille. Et c’est finalement cette douceur immense qui tombe sur l’empire du désordre, et recrée l’espace de la paix entre les membres disloqués des combattants, les cadavres, les survivants de l’incendie, de l’inondation et de la misère. Dans cette douceur, rien n’est omis, rien n’est censuré : l’atroce est là, confronté à la gloire insaisissable d’un homme qui a su faire de sa peinture le domaine sans frontières de la générosité.
Alain Jouffroy