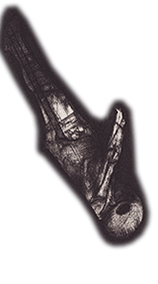Dado par Anne Tronche
Les Plages et l’équarrissage
Extrait du remarquable article d’Anne Tronche (1938-2015) paru dans son ouvrage L’Art des années 1960. Chroniques d’une scène parisienne, Paris, Hazan, 2012, p. 160-167. Nous devons également à Anne Tronche la précieuse préface du recueil d’entretiens de Dado parue aux éditions L’Atelier contemporain sous le titre Peindre debout.


Cliquer sur les images pour les agrandir
en grand et très grand formats
❧
Diaporama
plein écran

Photo : Centre Pompidou – Mnam – Bibliothèque Kandinsky – Fonds Vera Cardot et Pierre Joly.
Je regardais les mocassins piqués sellier s’enfoncer dans la boue par cette matinée pluvieuse du mois de novembre, quand il surgit, le cheveu en bataille, les vêtements sombres balafrés de couleurs multiples. Nous étions à Hérouval dans le domaine de Dado, entourés par des carcasses d’objets, des ossements curieusement entassés, le tout organisant un invraisemblable paysage de dissolution qui rappelait vaguement les stockages à l’air libre des ferrailleurs. Son marchand, André-François Petit, m’avait obligeamment proposé de m’accompagner en cette première visite à l’artiste monténégrin. À son habitude, il avait opté pour une mise élégante et ses fines chaussures devaient lutter contre l’envahissement du sol brun et boueux. Cela semblait amuser Dado qui, l’œil brillant, apercevait dans ce conflit entre élégance et réalité organique du sol en bourbier une sorte de représentation des relations qu’entretiennent la pensée civilisée et la pensée sauvage. Dans Malaise dans la civilisation, Sigmund Freud émet l’hypothèse selon laquelle notre civilisation serait liée à une dévalorisation du sens de l’odorat, à un dégoût des odeurs fortes ; on peut ajouter que notre crainte de ce qui salit, notre répulsion en regard de l’informe vont de pair avec les progrès de la vie urbaine. Ces considérations animaient probablement les pensées de Dado tandis qu’il nous conduisait vers un abri couvert. L’intérieur du premier corps de bâtiment, là où se trouvaient les espaces de la vie commune, n’était pas très chaud en cette période humide, les portes s’ouvrant fréquemment pour laisser passer un enfant, un chat, un poulet.

Photo : Centre Pompidou – Mnam – Bibliothèque Kandinsky – Fonds Vera Cardot et Pierre Joly.
(…)[V]oyant mon regard se porter sur un matelas placé dans la soupente que formait l’escalier de l’atelier, il m’avait indiqué que c’était la couche de l’un de ses fils. Dans cet atelier mal chauffé, l’endroit était pour le moins inconfortable. Il évoquait un mode vie spartiate, tel qu’en ont connu nos ancêtres dans les campagnes reculées. À son expression, je compris qu’il comptait sur notre étonnement, voir plus, pour nous renvoyer, André-François Petit et moi-même, à notre position de planqués dans la société de consommation. Sans doute l’attrait de la chose rudimentaire lui permettait-elle de réhabiliter des valeurs décriées par nos sociétés occidentales et de construire autour de lui un espace où le vécu personnel, l’expérience picturale et l’histoire des idées s’entremêlaient étroitement. Dado assujettissait tout ce qui l’entourait, les décharges autour de la maison, les espaces habitables, de même que la passion des déchets, à des rapports qui bousculent de fond en comble l’idée d’une activité artistique indépendante. L’obstination qui était la sienne à traiter ainsi ses lieux de vie tient à la nature même de son œuvre. À sa façon bien à elle d’envahir les lieux, de placer murs et sol sous son autorité, de tatouer les objets prosaïques contenus dans l’atelier. Comme si l’atelier n’était pas seulement le théâtre de ce qui s’y fabrique mais devenait également le pourvoyeur de motifs. À part les périodes où il se mit à décorer les murs d’une chapelle désaffectée, Dado est demeuré à Hérouval, au milieu de ces traces magnifiques mais précaires, tantôt peinture, tantôt dessin, tantôt griffure, tantôt objet. L’incendie de son atelier en 1989 n’avait paraît-il pas modifié sa façon de travailler, certains objets noircis par la fumée, altérés par la combustion s’étaient à nouveau trouvés intégrés à son environnement. Son indifférence à ce qui ne lui paraissait pas d’une nécessité première, son désintérêt pour tout signe de confort qu’on peut aisément interpréter comme l’effet d’une hostilité aux exigences de bien-être, sont probablement beaucoup plus complexes. J’y vois plutôt l’écho de la position adoptée par Blanchot vis-à-vis des buts de l’art : « soutenir, façonner notre néant ».

Photo : Centre Pompidou – Mnam – Bibliothèque Kandinsky – Fonds Vera Cardot et Pierre Joly.


À droite : Les Boulangers, 1968, huile sur toile, 80 × 80 cm.

Photo : Centre Pompidou – Mnam – Bibliothèque Kandinsky – Fonds Vera Cardot et Pierre Joly.